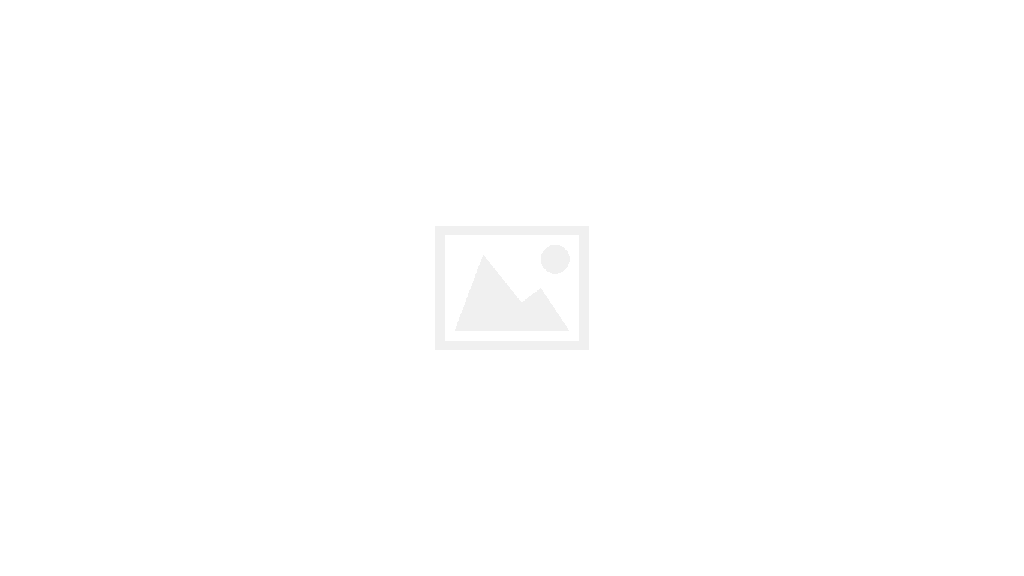Le passé, on n’en parle pas, « mais il y a une voix qui ne sait pas se taire et murmure des souvenirs comme dans un champ de mines ou de ruines ».
En 1954, le Front de Libération National, le parti politique socialiste algérien, est fondé afin d’obtenir de la France l’indépendance de l’Algérie. Les fellaghas qui forment la branche armée du FLN (ALN) enclenchent en 1960 les combats contre la France coloniale, jusqu’au cessez-le-feu en 1962, année de la proclamation d’indépendance du pays. Il s’agit-là du contexte historique dans lequel s’ancre le plus marquant, à l’échelle collective, des textes de Laurent Mauvignier, faisant de Des Hommes (Minuit, 2009) un livre qui s’inscrit dans le sous-genre du roman de guerre.
Le récit débute dans un bar paumé de la province française contemporaine. À l’occasion des soixante ans de sa sœur Solange, Bernard, pauvre et marginal depuis son retour de la guerre, lui offre un bijou de grande valeur, s’attirant ainsi les soupçons de l’entourage qui sait que l’homme est dans un état financier précaire. Animé par un désir de vengeance envers les soupçonneux, Bernard s’en prend au personnage dénommé Chefraoui, le seul Arabe du village. Il entre par infraction chez l’Arabe et passe tout près d’agresser sa femme et ses enfants. À partir de là se déplie le récit de mémoire fait par Rabut, le cousin de l’agresseur, afin d’éclaircir les motivations profondes qui ont conduit Bernard à devenir Feu-de-bois, surnom métaphorique exprimant littéralement celui qui se consume de l’intérieur. Dans un retour en arrière sombre et dense, Rabut plonge le lecteur au cœur de la guerre qu’il décrit grâce à des monologues imbriqués. Une absence de marques formelles mélange sa propre voix aux discours directs et rapportés des soldats, ce qui rend le récit puissamment cinétique. Sur le terrain, on mesure la présence de l’ennemi en arrivant après lui sur le lieu des massacres ; on découvre le corps du médecin qu’on a mutilé puis abandonné dans la poussière ; on se méfie dans la nuit de son propre souffle ; on pense aux lettres qu’on pourrait recevoir ; puis on se projette dans l’avenir, « quand tout cela sera terminé ». Le chapitre central fait s’enchaîner les images de barbarie et évoque les conditions précaires des soldats, il rappelle à une plus petite échelle le méconnu récit Le Feu, d’Henri Barbusse, qui relate l’horreur des tranchées, la camaraderie aussi malgré la maladie sur les lignes franco-allemandes en 1914-1918.
Mais si Des Hommes est effectivement un roman de guerre, le principal de son propos cadre les événements historiques en amont, c’est-à-dire interroge les traumas générés par le drame dans le quotidien d’hommes ordinaires appelés à combattre pour la patrie. En cela, le roman ne fait pas exception dans le parcours romanesque de son auteur, occupé depuis Loin d’eux (Minuit, 1999) à mettre en scène les conflits humains procédant d’angoisses et d’obsessions diverses. Cela dit, la dimension collective sur laquelle s’ouvre le « Je » distingue résolument cette œuvre des précédentes – un monde au-dessus duquel la transcendance radicale du réel (l’irreprésentable dirons certains) pèse toujours comme une épée de Damoclès, traînant son lot de honte silencieuse avec elle. En levant le voile sur le potentiel de fracture des êtres, là où précisément s’enracine le traumatisme justifiant le questionnement, l’auteur souligne à gros traits et avec une esthétique mélodramatique efficace, ce qu’Hannah Arendt a appelé « la banalité du mal ». Le sujet n’est pas la source même du mal, il en incarne les expressions ; les hommes de Mauvignier sont des hommes tout à fait normaux obéissant à la loi. Cela déplace une certaine logique de culpabilité : « Il [Bernard] ne sait rien, et […] cette idée lui fait honte […] Il pense à ce qu’on lui a dit de l’Occupation, il a beau faire, il ne peut pas s’empêcher d’y penser, de se dire qu’ici on est comme les Allemands chez nous, et qu’on ne vaut pas mieux ». Il finit cependant par se dire « que l’armée c’est un métier comme un autre […], être harki c’est faire vivre sa famille alors que sinon elle crèverait de faim ». Et quand Rabut regarde les albums photo de l’époque pour trouver des réponses, il constate qu’il ne reste plus que les souvenirs d’habits folkloriques devant des paysages de vacances. S’il souhaite gommer la mémoire « d’un passé qui fabrique des pierres, et les pierres, des murs » ; Rabut voudrait néanmoins « savoir pourquoi on fait des photos et pourquoi elles nous font croire que nous n’avons pas mal au ventre et que nous dormons bien ». C’est que le mal est embusqué en chacun des hommes. Le supporter, c’est ici masquer la guerre jusqu’à la faire passer pour la norme, avant de tenter de l’oublier. Tentative vaine s’il en est, car accepter l’événement traumatique qui s’y rattache en suppose la compréhension au moins partielle. Or personne ne comprend, « [p]as des hommes qui font ça. Et pourtant, des hommes ». Rabut témoigne – un « devoir » de mémoire qui peut, sinon expliquer, du moins aider à se rapprocher de cette impossibilité.
Texte © Annie Rioux – Photos © DR
Pour lire les autres textes publiés sur D-Fiction du workshop “Fermé le Jour-Ouvert la Nuit”, c’est ici.
ANNIE RIOUX a collaboré à divers périodiques, a enseigné le français à l’étranger, a travaillé dans le milieu des arts visuels.